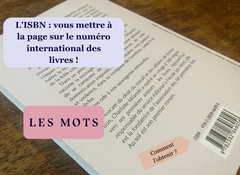Écrire à partir d'un paysage
Consigne : partir d'un paysage - quelque chose commence ou se termine dans ce lieu.
La vallée des chamémores
Le chemin des trolls a disparu sous les racines mais un nouveau sentier a été tracé. La montée est raide, j’ai le souffle court. Les sapins solennels à la beauté sombre sont ébouriffés par un vent facétieux. Les elfes caracolent dans les branches, les herbes chuchotent et les pierres protègent les nains des montagnes. Des clochettes et des étoiles chamarrées illuminent les sous-bois. Une ribambelle de trilles volète d’arbre en arbre. Un pic épeiche martèle mes pas. L’air vibre de senteurs d’humus, d’écorces et d’insectes affolés. Fleurs volantes et diptères virevoltent comme la cascade impatiente. La vie dévale la roche burinée. Les gnomes se cachent du soleil insomniaque, les trouées d’azur marquent le tempo. La sente abrupte se faufile jusqu’au sommet. Je m’égosille silencieusement. Le jour polaire se resserre et exhale une mélodie surannée. Les bouleaux ont quitté leur peau de dragon et tremblent. Une fourmilière géante nichée dans l’ombre m’évoque la folie impassible d’autrefois. Rouges et noires, airelles et carmines se tapissent dans la mousse. La terre palpite, la forêt respire mais l’air me manque. La berce, gardienne de la crête, tend ses griffes d’ours. Un dernier effort et me voilà arrivé.
La ferme séculaire aux rondins de bois a résisté au temps. Elle trône sur l’éminence la plus haute. Les épilobes de son toit végétal lui donnent un air rebelle et les chamémores invitent à festoyer. Le ciel immense a la transparence de l’eau. La blondeur aryenne des champs frémit sous une main invisible. Je m’assois sur le banc de pierre qui domine la vallée et le fjord. La montagne assoupie se reflète dans la mer avec une symétrie parfaite. Odin a fait couler le sang céruléen d’Ymir entre ses os. Les voiles des valkyries sont restées accrochées aux cimes. En contrebas, le ciel et la mer louchent sur la bâtisse immaculée. Les colonnades incongrues de l’hymne au clonage célèbrent le panthéon nordique. La pustule de perfection est devenue un hôtel dont les locataires éphémères ne connaissent pas l’histoire. Je les vois, minuscules qui s’affairent. Je les vois comme je les voyais il y a soixante ans avec mamma Liv, celle qui se disait ma mère.
J’ai mis toutes ces années pour comprendre le sens de ces randonnées hebdomadaires et des histoires qu’elle me contait. Elle prenait ma main dans la sienne, chaude et rassurante, et nous grimpions à travers champs jusqu’à la ferme. Là, elle me disait « Tu es fils de roi et voici ton royaume. Ton papa est parti conquérir le monde. Il reviendra bientôt, les bras chargés de trésors. Tu as beaucoup de chance ». Et elle riait. Elle était si belle. Les abeilles avaient tissé sa chevelure et l’eau des glaciers avait façonné son regard. Elle m’apprenait l’invisible et l’autre côté du miroir. Les champignons renversés dans l’herbe étaient les vestiges d’une bacchanale des lutins de la forêt. Il fallait se méfier de l’étang, antre de sirènes maléfiques. Elle avait une voix ensoleillée et à l’arrivée à la ferme, elle chantait la chanson de Solveig pour celui qu’elle espérait.
Parfois, elle prenait la clé dans sa cachette et m’invitait à entrer. Elle me présentait à ses parents, morts quand elle avait 17 ans. Ils nous souriaient dans leur cadre en bois. Elle me parlait de son frère Olaf, parti en mer et jamais revenu. La pièce était sombre, elle ouvrait les fenêtres vers la montagne et allumait des bougies. Il y avait une grande cheminée de pierre avec un chaudron de sorcière mais nous ne faisions pas de feu. Je m’asseyais sur le lit en bois à la silhouette de bateau et il m’arrivait de m’assoupir quelques instants dans les vagues de l’édredon. Bamse, l’ours qu’elle m’avait tricoté veillait sur moi. Il y avait des pelotes de laine de toutes les couleurs, que sa mère avait cardée et teintée. Il y avait aussi des aiguilles de toutes les tailles, des chaussettes et des pulls inachevés. Le rite était le même à chaque fois : elle se dirigeait vers le coffre en bois peint vert qui arborait fièrement les initiales de sa mère et des fleurs précieuses. Elle prenait avec précaution la nappe brodée blanche et les serviettes assorties, trois assiettes de porcelaine, les couverts en argent et les verres de cristal qu’elle déballait de leur papier de soie. Elle dressait la table et déposait les chandeliers, ainsi qu’un vase de fleurs séchées. Elle me conviait ensuite. Je devais rester bien droit sur ma chaise, les mains à plat de part et d’autre de mon assiette. Quand nous étions prêts, elle s’adressait à Hilda, la statuette en bois sculptée par son père et l’esprit de la ferme disposait des mets délicats. Les flammes dansaient dans les verres et mamma Liv versait quelques gouttes de nectar divin. Les arômes se faufilaient dans notre château et dans nos têtes, et nous savourions avec cérémonie les plats aux noms mystérieux. Le banquet terminé, mamma Liv se levait et son corps dessinait des arabesques dans l’espace qui s’agrandissait. Elle avait les yeux fermés et fredonnait. L’orchestre jouait une valse. Quand il était l’heure de partir, elle me murmurait : « Ne parle jamais aux autres de notre festin. Nous sommes les seuls à pouvoir l‘accueillir ».
Lorsque nous redescendions, nous devions nous hâter car aucun retard n’était toléré. Une armée de vraies mamans à l’uniforme blanc nous attendait en rang serré et mamma Liv disparaissait. La troupe d’enfants reprenait corps. Nous avions le même âge et nous étions blonds aux yeux bleus. Les garçons avaient les cheveux courts, les filles un ruban dans leurs cheveux mi-longs. Nous étions habillés à l’identique, culotte courte et chemise pour les garçons, jupe courte et chemisier pour les filles. Bleu et blanc. Nuit et neige. Le seuil franchi, la porte était refermée sur le chaos extérieur, les souliers étaient rangés et nous étions comptés. Le silence se propageait le long du couloir et nous entrions d’un même pas dans la salle des glaces pour célébrer dignement notre père à tous, moustachu colérique, qui nous scrutait dans toutes les pièces de notre maison. Ses messagers, fantômes noirs à la voix métallique, veillaient à l’ordonnancement de nos repas. Nos vraies mamans nous distribuaient des rations équilibrées de viande et de légumes. Le verre sans tain des murs de la salle à manger multipliait nos gestes en un mime infini. Nos reflets se répétaient en écho silencieux. Nous étions deux cents enfants, fruits du croisement d’étalons nazis et de jeunes norvégiennes racialement valables. Un éleveur de poulets avait décidé de cette reproduction contrôlée pour fournir un sang génétiquement validé à l’empire de mille ans. Venaient s’y ajouter « les autres », enfants prélevés dans les pays slaves et destinés à une germanisation accélérée. Nous devions tous parler allemand, la seule langue pure. Les slaves étaient d’abord parqués dans le petit réfectoire, le temps de l’acclimatation. Ils étaient inconscients de leur bonne fortune et leurs pleurs étaient trop bruyants. Le dîner terminé, venait l’heure des ablutions, avant d’accéder à nos chambres. Nous étions regroupés par sexe et nos lits alignés dans une monotonie impeccable nous attendaient. Pour nous aguerrir, les dortoirs n’étaient pas chauffés, et à l’approche de Noël, la clarté hivernale peinait à traverser les fleurs de givre sur les fenêtres. Le matin, le cérémonial immuable voué au culte de père recommençait. Lever à l’aube. Habillage. Course dans la montagne. Retour. Déshabillage. Purification à l’eau des glaciers. Habillage. Petit-déjeuner. Chant de gratitude à la gloire de père. Heure des fantômes noirs. Exposé guerrier. Déjeuner frugal. Art des seigneurs et lecture. Jeux d’équipe. Dîner. À chaque nouvelle lune, un médecin allemand venait nous examiner pour détecter d’éventuelles tares. Nos mensurations alimentaient nos courbes de croissance, gage du bon fonctionnement de notre maison. Notre premier dessin a été une croix gammée, nos premières lettres sifflaient comme des serpents et traçaient des éclairs. Nous étions reconnaissants d’être une race supérieure, de ne pas avoir des mains d’araignées et le dos voûté des démons souterrains. Nous apprenions le port altier et le mépris de la lie de l’humanité. Notre tâche était d’assainir le monde et à cette fin, les filles avaient le devoir d’être de bonnes épouses pondeuses. Les adultes nous montraient l’exemple. La pouponnière ne désemplissait pas.
Quand mamma Liv a disparu définitivement, les jours ont succédé aux jours et mon norvégien s’est effacé. L’exaltation est devenue morne et j’ai arrêté d’attendre. En partant, elle avait dû laisser la porte ouverte car le chaos s’immisçait insidieusement dans nos murs. Les fantômes noirs avaient le verbe de plus en plus haut et les vraies mamans semblaient désorientées et inattentives. Nous goûtions à une liberté inquiétante. La cacophonie s’installait. Tandis que le noir, le rouge et le blanc se déchiraient avec fracas, les couleurs de l’arc-en-ciel se promenaient subrepticement dans mes dessins. Un jour de grande agitation, les fantômes noirs et les vraies mamans ont fait un grand feu avec des papiers et se sont soudain volatilisés comme les cendres. Je m’étais réfugié à la ferme et je les ai vus se disperser dans un désordre total lorsque la colonne de camions kaki s’est approchée de la « fontaine de vie », le lebensborn. Les enfants ont été rassemblés et des soldats sont venus me chercher. Ils étaient si gentils que je n’avais plus peur et je me réjouissais à l’idée de voyager et de retrouver mon père.
À l’arrivée au centre de tri, nous chantions tous en chœur notre patrie germanique et notre joie de ces vacances impromptues. Une organisation familière nous a pris en charge, avec ses bataillons d’hommes et de femmes aux nuances sceptrales. Nous avons été classés par sexe et par âge, puis nous avons été examinés, mesurés et pesés. Nous ne craignions rien puisque nous étions les puissants, gouvernant depuis les cieux. Nous avions déjà passé ces épreuves et méritions nos places. Le deuxième jour, un escadron de médecins d’Oslo nous a interrogés dans la langue de mamma Liv. J’en connaissais la mélodie mais n’en comprenais plus le sens. J’ai répondu en allemand et un médecin m’a déclaré mentalement déficient. Moi, l’enfant de roi, je suis devenu alors l’enfant de boche, sans identité, aux gènes dégénérés. J’étais un bâtard dangereux, un monstre à enfermer dans un asile pour protéger l’humanité.
Vingt ans. Vingt ans d’enfermement entre quatre murs et en moi-même. Vingt ans de cris, de bave, d’urine et d’excréments. Autre alignement de lits, d’assiettes et de jours. Autre rangée de blouses pour lesquelles l’altérité est transparente. Débile parmi les fous. Fou parmi les débiles. Mon existence était une insulte au pays. J’ai été transformé en objet de curiosité, objet de vexations, objet sexuel, objet d’expérience. Je m’évadais grâce à la voix de mamma Liv. Nos conversations muettes me portaient sur ses ailes et m’offraient une armure de protection. J’étais invulnérable, hermétique à ce monde. J’ai grandi en enfouissant mon passé et en dessinant. Je dessinais l’Yggdrasil et les elfes de lumière. Je dessinais la ronde muette de mamma Liv et les poussières d’étoiles. Je dessinais son frère Olaf parti en mer. J’étais « celui qui dessine ». Les années se suivaient, les psychiatres n’étaient jamais les mêmes. Ils m’examinaient, encore et encore dans une indifférence polie. Puis est arrivée Lillemor à la blouse blanche invisible, qui a su entendre mes esquisses. En m’offrant un coffret de couleurs, elle m’a dit : « Harald, tu as du talent, continue. Je serai très fière d’exposer un de tes tableaux chez moi ».
Elle connaissait des jongleurs de mots et de couleurs, des funambules de dièses et de bémols, et a guidé ma renaissance. Je suis devenu un peintre reconnu, adulé par les critiques d’art, soucieux de découvrir la clé de mon génie : « Vos tableaux ont une dominance de bleu et de jaune. Quelle en est la symbolique ? ». Pourquoi leur dire que ces couleurs m‘ont tellement défini à une époque que je les ai exécrées, que j’ai sans cesse cherché le nuancier de l’oubli, ma « comatine », avant de réaliser que le vert du désert est issu du soleil et de l’eau ? Alors j’ai toujours répondu que j’étais daltonien. Ida a été la seule à éclater de rire, à ne pas croire en ma cécité des couleurs, à deviner mes origines. Blondeur d’ébène et azur de charbon, elle s’est présentée comme spéléologue des arbres et depuis, elle déroule le fil d’Ariane dans notre vie. Nos enfants et petit-enfants bigarrés sont venus nous rejoindre dans notre quête d’identité et de liberté mais une ombre est restée au fond de moi. Chatoiement des gènes. Si ce n’était la colère d’adolescente de Lucie et son exhortation à ne plus taire les secrets de famille qu’elle avait pressentis, la promesse à mamma Liv serait restée prisonnière de la grotte des oublis. Il est temps pour moi d’honorer notre pacte, d’exhumer la boîte à trésor que nous avions enterrée avec des airs de conspirateurs. Elle m’avait dit : « Voici le secret de ta vie, prends-en bien soin ».
En creusant sous le banc, j’ai l’impression de profaner une tombe. La boîte métallique est là, rouillée et cabossée. Je n’ose y toucher et les battements de mon cœur ont pris un rythme de cheval fou. Je regrette d’être venu seul. Quand je parviens à ouvrir la cassette, elle révèle une lettre, des photos, une mèche de cheveux et mamma Liv m’annonce que j’ai un jumeau.