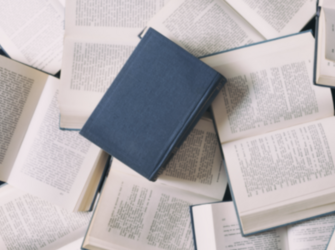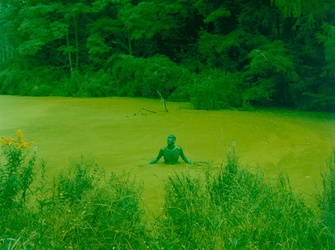L’écriture de soi : l’autofiction
Comprendre le genre de l’auto-fiction
L’autofiction est un genre littéraire très particulier, différent du roman autobiographique, ou du récit autobiographique. Mort à crédit de Céline, est une autofiction au sens où le nom de l'auteur est effacé, mais pas son vécu. Cette fictionnalisation de soi propre à l'autofiction entraîne toujours une triple identité pour la voix narrative, qui est à la fois auteur, narrateur et personnage.
Dans ce phénomène littéraire, ce récit réel, où votre existence, votre personnalité et votre identité sont les caractéristiques de votre matière narrative, votre liberté d'écriture s'arrête où votre vécu rencontre ses limites. Il ne s’agit pas de romancer l'enfant que vous étiez, ou d'inscrire simplement son texte dans une catégorie textuelle, il faut donner un sens autofictionnel, en liberté, à votre passé. Vous allez fictionnaliser votre nom, et trouver un langage nouveau pour chaque “Je” épisodique.
Une intrigue adoptant les codes de l'autofiction, et un dispositif autofictionnel place le lecteur au seuil entre réalité d'une situation et effet narratif. L’auteur trouve un écho dans le narrateur, et place l'intérêt de son récit dans ce réel devenu fiction où le héros partage le désir de l'écrivain. Les faits et événements retrace le siècle vécu. Le passé, le présent et l'avenir du récit son propre à une époque. En bref, l'autofiction définit son cadre et l'attente du lecteur en fonction du réel.
Dans la masterclasse d'écriture de Chloé Delaume vous partirez à la rencontre d'une longue liste de livres via des extraits de textes fondamentaux : Serge Doubrovsky, Nelly Arcan, Christine Angot, Hervé Guibert, Annie Ernaux, Philippe Forrest, Camille Laurens, Céline, Gérard Genette, Robbe-Grillet, Lejeune, Vincent Colonna, Amélie Nothomb, Hervé Guibert Marguerite Yourcenar, Violette Leduc, Marcel Proust, Philippe Gasparini, Colette...
Comment s’écrire ?
Un jour ou l'autre, on sent qu'on a une histoire à raconter. Quand ce jour arrive, le silence est comme brisé. Alors, on franchit le seuil dont parle Jacques Lecarme et Philippe Lejeune, entre soi et l'écriture. Comme le critique littéraire du XXe siècle Roland Barthes, on donne du sens à notre pulsion autobiographique, on se laisse faire par des émotions à exprimer, des expériences et des événements à décrire, des joies et à l'inverse des peines, des rencontres et des échecs professionnels, des amours et des divorces, des naissances et des morts.
Nous avons tous la tentation, pour certain c'est un défaut, de vouloir écrire ce qui nous arrive. On passe un pacte avec nous-même, et on se figure que l'écriture sera capable de nous faire comprendre, soit notre relation avec notre mère (les exemples de Proust ou de Roland Barthes...), soit la fin malheureuse d'une relation (Philippe Vilain), on s'arroge le droit de raconter notre vie pour mieux préparer notre futur. Ce travail nous définit, nous transforme et nous fait évoluer. Mais, pour faire un roman de soi, de son vécu, de ses expériences, il ne suffit pas d'être ouvert à l'inconnu, de choisir un fait ancien, de lui trouver un titre et de mettre un point final à notre projet. Après tout, mon cas est-il si intéressant ? Ma vie est-elle celle d'un personnage principal ? Par où dois-je commencer ? Quand j'étais l'enfant, le fils, la fille ? Ma mémoire est-elle si fiable ? Dois-je écrire à la première personne ? Un essai ? Un Roman ? Quel doit être mon point de départ ?
L’auteur Philippe Vilain, (La dernière année ou L'étreinte chez Gallimard ) anime régulièrement l’atelier par correspondance “S’écrire”. Cet atelier a pour vocation de sensibiliser aux techniques permettant de construire un récit de soi sur soi en littérature : en somme d’illustrer la question « Comment s’écrire ? ».
L’idée est que l’écriture autobiographique ne s’improvise pas. Roland Barthes par Roland Barthes ou bien À la recherche du temps perdu, n'ont pas étaient écrit au gré de l’inspiration. Dans cet atelier d’écriture vous chercherez à méditer les événements et les émotions fortes de votre vie afin d’essayer de faire œuvre de soi, grâce à une véritable aventure du langage.
Quelle forme choisir pour écrire sur soi ?
Quelle forme choisir pour raconter mon histoire de la façon la plus juste mais aussi la plus attirante pour des lecteurs qui ne me connaissent pas ?
Cette question est pertinente et même passionnante car elle nous pousse à redéfinir ce qu’on attend de l’écriture et quelle vision on a de son livre idéal, un livre à soi.
La forme est l’épaule sur laquelle se reposer quand la crainte que peut nous inspirer l’idée d’écrire sur soi, sur son entourage, sur un évènement que l’on a vécu, est trop forte. Elle est ce pont entre nous et le livre à venir, un moyen de mettre à distance tout en disant ce qui nous tient si fort à cœur, ce vécu que l’on a en soi, ce secret de nos vies.
L’auteur Gilles Sebhan vous propose un atelier d’écriture sur cette question bien spécifique. Grâce à de nombreuses propositions d’écritures variées, à la fois ludiques et sérieuses, autobiographie d’un objet, autoportrait négatif, évocation de soi à la troisième personne...vous finirez par découvrir la forme qui vous conviendra le mieux. Autobiographie, autofiction, roman. Tout est possible. Gilles vous accompagne pour tenter de vous éviter l’embarras du choix.
Écrire un roman d’auto-fiction
Difficile néanmoins de déterminer ce que signifie réellement l’autofiction tant les définitions se déclinent.
Pour s’y retrouver, et se débarrasser de cette question, voici les mots d’Annie Ernaux : « La fiction c’est la forme, ce n’est pas l’invention ».
Tout mot écrit est fiction, quel que soit le sujet. Quand le sujet est soi-même, le chemin vers les mots, vers la page écrite est le même : il devient un terrain d’écriture, une forêt dans laquelle il faut se frayer un chemin, tailler à la serpe parfois pour arriver à écrire son histoire. Il faut choisir ce qu’on va raconter et ce qu’on va omettre, trouver le narrateur de son histoire, en somme : il faut trouver une forme.
Dans son atelier d’écriture L'Autofiction : transformer son vécu en matière littéraire , Elsa Flageul vous propose de faire le tour de ce genre si particulier, tout en vous montrant sa grande différence avec le genre de l'autobiographie. Dans un premier temps vous déterminerez les contours de votre roman d’auto-fiction : son sujet, son cadre, sa forme, puis dans un second temps, vous commencerez à le dérouler, à l’expérimenter.
Écrire sur soi : l’astuce pour se lancer dans l’écriture
Vous avez toujours voulu écrire. Votre lecture d'un roman français, d'un roman russe ou d'un essai, vous a inspiré. Mais il est difficile de vous lancer dans le grand bain de l’écriture. Vous avez peur de ne pas arriver au bout d’un récit tout seul. Le chemin à emprunter vous paraît nébuleux. Chaque histoire que vous inventez vous paraît ou trop monumentale ou trop minime. Ou alors vous manquez d’inspiration.
Regardez, vous avez tout : le lieu, le décor, les personnages. Quant à l’intrigue ? Nous vous aidons à la trouver ! Prenez vos archives, vos photos, vos témoignages, prenez vos bons et vos mauvais souvenirs, prenez votre bonne comme votre mauvaise foi et faisons le tri ensemble lors d’un atelier d’écriture dédié.
La puissance du “je”
Parler de soi tout en touchant les autres. Le défi est audacieux ! Il faut partir de votre personne réelle, de ce qui vous fait souffrir, réfléchir ou vibrer, et transformer ce qui vous habite en narration. Il faut faire de votre écriture un miroir qui revient sur votre vie.
Un texte auto-fictif a autant de force littéraire qu’un grand roman d’aventure. Lisez des récits d’auto-fiction tels que Marguerite Duras, Annie Ernaux ou Anaïs Nin, dont le journal intime est incroyablement romanesque. Le pouvoir du « Je » introspectif vous paraîtra beaucoup plus puissant.
Quand l’autrice Adeline Fleury s’est lancée dans l’écriture d’un texte très intime, elle-même n’avait pas mesuré la portée universelle de son récit.
L’écriture au « Je » a une force indéniable, elle peut être un médium pour témoigner des bouleversements de la société, le succès du Consentement de Vanessa Springora en est la preuve. Tentez l’expérience et faites de votre « je » un universel.
Auto-fiction : la quête de vérité
L’autrice Sonia Feertchak en a fait l’expérience lorsqu’une ancienne participante lui a raconté le cri du cœur d’une éditrice sollicitée : « Ah mais il fallait me dire que tout est vrai ! Le texte sera beaucoup plus facile à vendre ! ».
Entre autobiographie, autofiction, exofiction, contrat de vérité et pacte auteur-lecteur, la nouvelle littérature est en pleine évolution et semble désormais obsédée par la vérité. Mais quelles sont les règles pour « écrire vrai » ? Y a-t-il une prime aux histoires réelles ? Et, surtout, qu’entend-on par vérité ? Comme disait Boris Vian, « L’histoire est entièrement vraie, puisque je l’ai imaginée d’un bout à l’autre ».
Prenons l’exemple de l’autrice Agatha Christie qui s’est révélée dans ses romans, et cachée dans son autobiographie. Elle s’est dédoublée en Mary Westmacott, et a usé de doubles au sein des romans signés sous ce pseudo. Elle s’est approchée du « Je ».
La grande leçon que donne Agatha Christie, c’est qu’il ne faut pas chercher la vérité – ça c’est vous, nous, lecteurs, qui tentons de la débusquer – il faut chercher la véracité. Sur le sujet, Agatha est une mine. En cinquante ans de carrière, l’auteure d’une des œuvres les plus lues dans le monde, auteure qui, pourtant, ne se sentait pas écrivain, a eu l’occasion de réfléchir à cette notion. Son Autobiographie, entre autres ouvrages, est l’occasion de remarques et conseils sur le processus d’écriture, la place de l’auteur selon les genres littéraires, la maturation des intrigues, les personnages et les lieux, la longueur des textes, l’utilisation du matériau, le réel et le véridique, l’art du dialogue...
Le cas de l’exo-fiction : s’écrire en partant d’autrui
Biographie romancée ou roman biographique ? C’est la question principale que l’on a posée à l'autriche Olivia Elkaim quand Je suis Jeanne Hébuterne a été publié en 2017.
Son roman s’inspirait de la vie de celle qui fut la muse et la dernière femme du peintre Amedeo Modigliani. Il intégrait des éléments historiques réels dans un récit de pure fiction. Olivia Elkaim inventait des dialogues et surtout les pensées et ressentis de cette jeune fille qui a vraiment existé il y a cent ans. Ce n’était donc ni une biographie romancée ni un roman biographique, mais une sorte d’ovni littéraire qu’on qualifie, depuis quelques années : exo-fiction. Soit une sorte d’autofiction à l’envers : l’écrivain sort de lui-même, bâtit le récit d’un autre pour en réalité parler de lui. Il en est ainsi de « Charlotte » de David Foenkinos, de « Limonov » d’Emmanuel Carrère ou de « Je vous écris dans le noir » de Jean-Luc Seigle, entre autres.