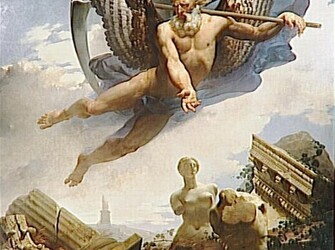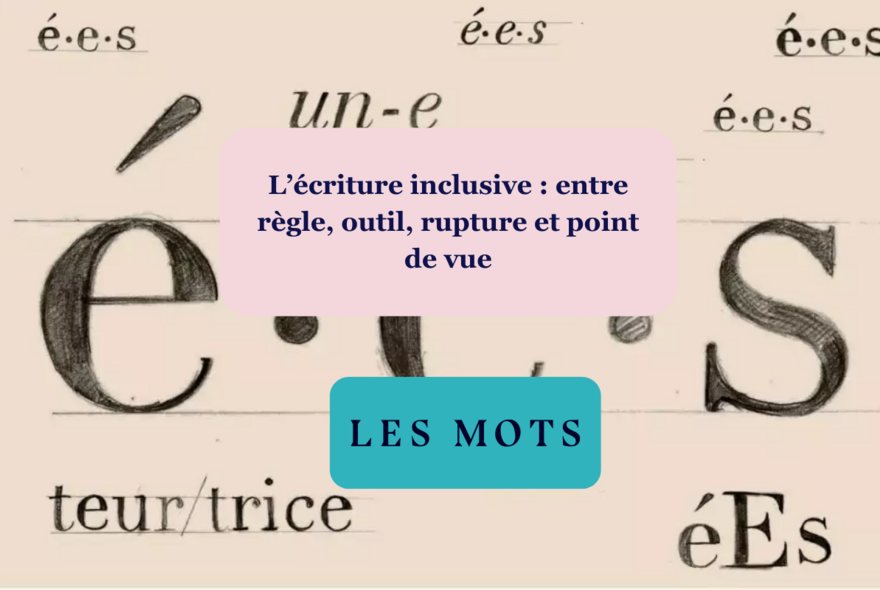
L’écriture inclusive : entre règle, outil, rupture et point de vue
L’écriture inclusive : quand utiliser le masculin neutre ne suffit plus
Le masculin générique vaut pour neutre en français : voici l'enseignement qui semble, en principe, aller de soi depuis des siècles. Mais, pour répondre aux enjeux de la lutte contre le sexisme et les discriminations de genre, pour éviter de favoriser l'invisibilisation des femmes dans la langue, le droit demande l'application d'une nouvelle graphie dans les textes : l’écriture inclusive. Un sujet dont la raison première est l'égalité, et qui pourtant déclenche des débats houleux au niveau national. Utilisation du point médian, double flexion, usage des mots épicènes : cette nouvelle manière d'écrire jugée trop complexe par certains est à l'origine d'un débat linguistique, social et politique qui touche l’école, le web, les manuels, les discours de ministres et même les circulaires nationales !
Faut-il écrire « les maîtres » ou « les maîtres·esses » ? Peut-on parler d’égalité entre les femmes et les hommes sans féminisation des noms de métier ? Le langage façonne-t-il vraiment la représentation sociale des genres ? Le français inclusif peut-il exister ?
Dans cet article, nous vous présentons un guide pratique pour comprendre, utiliser, ou critiquer, l’écriture inclusive.
Qu’est-ce que l’écriture inclusive ?
L’écriture inclusive, définition
Entre stratégie de communication, prise de conscience, préférence personnelle, et revendication féministe, l’écriture inclusive n’est pas quelque chose d'anodin, et sa définition ne peut pas être simpliste. L'usage du point médian est une question de liberté, de respect et de pouvoir. L'écriture inclusive est donc essentielle à la formation d'un langage non sexiste, tout comme les titres d'autrice, d'auteure, ou d'écrivaine permettent de lutter contre un stéréotype de sexe ou de genre présent dans la phrase et la mentalité françaises.
L’écriture dite inclusive est une somme de pratiques linguistiques qui, en s'efforçant de considérer que le genre masculin n'est pas un genre neutre, veut assurer une représentation égalitaire des femmes et des hommes dans la langue française. Les notions visant à produire une version d'écriture non sexiste sont les suivantes : l'écriture épicène, le langage épicène, la grammaire égalitaire, la rédaction inclusive ou encore l'accord de proximité. Chaque forme cherche à dépasser l’invisibilisation du féminin dans les textes.
L’objectif principal de cette pratique est triple : rendre visible le genre féminin au plus grand nombre, refléter une égalité entre les femmes et les hommes dans les discours, et proposer une représentation linguistique plus conforme aux valeurs contemporaines (jusque dans la loi).
L’usage de l’écriture inclusive répond donc aux problématiques de notre temps, et varie en fonction d’un choix personnel, d’une recommandation institutionnelle ou encore d’un engagement militant.
Les origines : avancée féministe et linguistique
Comme le met en avant la chercheuse Éliane Viennot, la langue française est historiquement binaire et façonnée autour du masculin. Depuis le XVIIe siècle, la forme masculine l’emporte sur le féminin, notamment dans les accords au pluriel.
Mais cette règle n’est pas immuable, et n'a pas toujours été en vigueur : c'est une décision relevant de l'Académie Française, et qui encore aujourd'hui est mise en avant par des académiciens comme Jean Dubois. Cependant, l'Académie ne semble pas réussir à avoir le dernier mot. D'une part, au niveau populaire, les mentalités changent dans les cours d'école, et les petites filles comme les petits garçons remettent en question l'hégémonie du masculin générique, d'autre part, même à l'assemblée, des députés et députées luttent pour que l'écriture inclusive soit instituée dans leur milieu. Enfin, puisque l'égalité semble être à portée d'un tiret, d'un point médian, ou d'un pronom, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE), met en place depuis quelques années une véritable campagne de sensibilisation à l'écriture inclusive.
L’écriture inclusive propose donc une formulation neutre, une nouvelle graphie ou une relecture des normes existantes pour rétablir un équilibre symbolique et concret.
Les formes de l’écriture inclusive
Typologies et exemples
● Tout d'abord, le point médian permet une économie d’espace tout en incluant les deux genres. Il donne « les étudiant•e•s » ou « les salarié•e•s ».
● La double flexion consiste à mentionner les deux genres grammaticaux. Par exemple : « les candidats et les candidates ». C’est une formulation simple, directe, qui évite l’usage du masculin dans la langue comme valeur par défaut.
● Le slash, le tiret, ou les parenthèses sont parfois utilisés comme variantes au point médian, notamment lorsque celui-ci pose problème sur certains supports numériques. Chez Les Mots, nous utilisons les parenthèses !
● Les mots épicènes offrent une autre solution. Ce sont des termes qui ne marquent pas le genre, comme « élève », « personne » ou « responsable ». Leur utilisation permet une rédaction non sexiste, tout en restant naturelle.
● Enfin, on peut utiliser des accords de proximité, où le mot le plus proche détermine le genre grammatical de l’adjectif. Cette règle était l’usage avant que les marqueurs féminins ne soient effacés par les académiciens à partir du XVIIe siècle !
Débats, résistances et légitimité : féminin, masculin, femme, homme, pourquoi l'un ou l'une l'emporte ?
Les arguments des défenseurs
Les penseurs de l’écriture inclusive avancent plusieurs arguments majeurs. Le premier c'est la représentation : le langage inclusif rend les femmes, les filles, les minorités de genre visible dans la langue française.
D'autre part, les études de Pascal Gygax en psychologie cognitive montrent que le masculin neutre entraîne des biais de perception : les lecteurs imaginent toujours des hommes, même si le contexte est mixte.
Dans les universités, les débats sont vifs mais la recherche linguistique, les sciences sociales et la sociolinguistique y trouvent un terrain d’étude précieux. Les recherches montrent en effet que la formulation neutre devient un outil d’inclusion et un levier de transformation des mentalités.
Les critiques et résistances
Les opposants ont fait naître une véritable controverse ! Ils évoquent plusieurs problèmes : la lisibilité est le premier.
Pour eux, le point médian rend la lecture ardue, en particulier pour les dyslexiques ou les élèves en difficulté. Certains enseignants et professionnels de l’éducation nationale redoutent une surcharge inutile.
De son côté le Conseil d’État interdit l’usage du point médian dans les documents administratifs et scolaires. L’Académie française parle d’un « péril mortel » pour la langue française...
Beaucoup perçoivent l’écriture inclusive comme une importation anglo-saxonne inadaptée au cadre grammatical français. Elle serait le fruit d’un milieu militant, en rupture avec la tradition. Ce qui aboutit à une opposition politique : l’écriture inclusive étant perçue comme un outil de division ou un symbole du “wokisme”. Elle devient alors un objet de clivage générationnel, idéologique, voire territorial.
Écriture inclusive en pratique : usages, contraintes et stratégies
Mise en œuvre dans les milieux professionnels
Mais dans les faits, l’écriture inclusive est utilisée dans de nombreux milieux professionnels ! Certaines universités, entreprises ou institutions publiques ont mis en place des chartes de rédaction inclusive ou de communication publique sans stéréotype.
Dans l’administration, des circulaires nationales encadrent partiellement les usages : des chartes RH incluent la féminisation des noms de métier et la formulation neutre dans les documents internes.
D'un autre côté, le marketing inclusif gagne du terrain. Les marques adoptant une communication non sexiste valorisent leur engagement RSE et touchent une audience plus large et diversifiée.
Sur le web, la rédaction épicène devient une stratégie de différenciation importante pour la communication des marques.
L’écriture inclusive comme révélateur sociolinguistique
Un miroir social : l’écriture inclusive comme baromètre des tensions sociales
Au-delà des usages, l’écriture inclusive révèle certains clivages sociaux. Son acceptation ou son rejet met en relief les fractures générationnelles et les oppositions idéologiques.
C’est aussi un révélateur des inégalités : qui a accès au discours public, qui décide des règles, qui est nommé ou ignoré ?
La grammaire française n’est pas neutre : elle est un reflet de la société.
Vers une évolution de la langue ou vers un plurilinguisme idéologique ?
Faut-il instaurer une norme inclusive dans les dictionnaires et les manuels scolaires ? Ou au contraire assumer une coexistence de normes, selon les contextes, les milieux et les préférences ?
Certains plaident pour une grammaire politique, à la fois rigoureuse et respectueuse des valeurs d’inclusion. D’autres pour une souplesse linguistique qui permette à chacun de choisir sa formulation.
De son côté, l’office québécois de la langue française propose un guide pratique d’écriture inclusive, fondé sur des formulations épicènes, l’ordre alphabétique et le recours limité au point médian.
En France, le débat reste complexe.
Mais l’écriture inclusive est là pour rester. Non comme une langue parallèle, mais comme un outil linguistique, une proposition sociale, une forme d’expression qui, bien que contestée, porte en elle une force profonde.